
 |
Emile Masqueray et les études linguistiques berbères |
| Par
"études berbères" nous entendons les différents
travaux d'intérêts linguistiques menés par Masqueray
lors de sa carrière algérienne : chargé de missions
scientifiques (1975-1880) puis directeur et professeur à l'université
(1880-1894). Il s'agit d'étudier cette œuvre et de l'évaluer. Pour mener ce travail, nous nous sommes basé sur une correspondance inédite provenant des fonds de la Commission des voyages et des missions, section Lettres et Sciences, du ministère de l'Instruction publique ; en outre des lettres privées adressées à son ami de l'Ecole normale supérieure, Alfred Rambaud, nous ont été d'un secours appréciable. De cette documentation relativement importante à laquelle s'ajoutent des sources imprimées, nous avons tiré une matière consistant à reconstituer les différentes missions scientifiques de Masqueray, ainsi que des éléments relatifs à la vie universitaire intense à Alger (programmes de cours, professeurs nommés, travaux réalisés,…). Enfin, nous avons pu, à travers tous les matériaux réunis, reconstituer le contexte de production et apprécier cette œuvre proprement linguistique de Masqueray, abordée de front avec d'autres disciplines. En effet, nous avons affaire à un personnage complexe, à plusieurs facettes. Notre travail a mis des mois, voire des années, pour qu'il corresponde à l'intitulé Emile Masqueray et les études berbères. La thèse, qui a été remaniée plus d'une fois, est composée maintenant de deux parties distinctes. La première qui introduit la seconde, présente l'homme de sciences Masqueray dans le contexte académique de l'époque. La seconde partie constitue le vif du sujet, c'est-à-dire les études linguistiques berbères, à proprement parler, de Masqueray. C'est à la fois de définir le champ scientifique et de présenter les différents travaux du directeur de l'Ecole supérieure des Lettres d'Alger et du professeur d'histoire des antiquités nord-africaines et, en même temps, les situations historiques. Une bonne part est faite au vernaculaire, c'est-à-dire une étude fine des différents dialectes abordés par le pionnier berbérisant. C'est de montrer, à la fois, les apports réels et les limites de l'entreprise. L'œuvre linguistique de Masqueray a quand même servi de coup d'envoi pour les travaux des berbérisants de la génération suivante. Cela dit, il y a une certaine homogénéité dans la carrière. En effet, d'octobre 1872 à sa mort, le 19 août 1894, la carrière de Masqueray a été algéroise : professeur d'histoire au lycée et, avec la création de l'Ecole supérieure des Lettres d'Alger - dont il fut depuis sa fondation en 1880 jusqu'à sa mort - directeur. Plus encore, à part un article de 1873 sur le Gulf Stream, toute son œuvre scientifique fut consacrée à l'Afrique du Nord. De l'année 1875 jusqu'à sa mort, soit pendant près de vingt ans, Masqueray n'a cessé de travailler : mais les éléments les plus récents de cette œuvre sont aujourd'hui vieux de plus d'un siècle : ce qui est beaucoup dans des disciplines comme la berbérologie, dans des terrains de défrichement où les choses vont, malgré les apparences, relativement vite. En ce temps là, plus que maintenant encore, toute découverte, travail ou premier apport est somme toute facilement "périssable". Notre travail sur ce pionnier, on le concevra, ne sera donc pas un panégyrique : Masqueray a disparu depuis bien longtemps ; il appartient au passé. On peut donc parler franchement et sereinement de son œuvre; mais n'eut-il pas mieux valu dans ces conditions accorder moins d'attention à ses écrits et laisser Masqueray en paix ? Nous ne le pensons pas. Tout d'abord son œuvre n'est pas oubliée : en 1914, on rééditait ses Souvenirs et visions d'Afrique qu'Augustin Bernard faisait précéder d'une notice sur l'auteur et d'une bibliographie de ses travaux ; en 1930, Robert Montagne en étudiant l'organisation politique berbère dans le Sud du Maroc ramenait l'attention sur la thèse de Masqueray : Formation des cités chez les populations sédentaires d'Algérie (Kabyles du Djurdjura, Chaouïa de l'Aourâs, Beni-Mzab), et dans le même temps Emile-Félix Gautier n'hésitait pas à faire état - imprudemment - d'hypothèses de Masqueray sur le peuplement de l'Aurès… Plus récemment encore, ces deux œuvres ont fait l'objet de nouvelles éditions. C'est dire qu'une appréciation de ces travaux n'est pas inopportune qu'il ne s'agit pas seulement de mettre à jour un point d'histoire. En second lieu, le berbère est aujourd'hui, tant en France que dans les pays du Maghreb, à l'ordre du jour ; il n'est pas inutile de tenter quelques bilans sur les études berbères. Le travail pionnier de Masqueray pourrait bénéficier d'une telle contribution, un apport certes partiel mais utile pour la compréhension de quelques chaînons et même de l'ensemble de la chaîne. Même si d'emblée l'œuvre linguistique de ce savant peut s'avérer dépassée aujourd'hui, il n'en reste pas moins qu'une bonne part de "grain" peut encore susciter de l'intérêt, et peut-être encore servir d'objet de recherche en sciences sociales. Les travaux entrevus ici (majoritairement linguistiques) ont évidemment une valeur historique ; ils reflètent une époque et en portent le témoignage, aussi constituent-ils un des jalons dans la chronologie. Ils sont, à plusieurs titres, très précieux. Une chose capitale : effet de la différence fatalement à une plus grande spécialisation à mesure que la science devient de plus en plus fine et de plus en plus précise et multiplie ses acquisitions, effet également des différences de tempéraments qui font qu'une optique d'un chercheur contemporain ne pourrait être celle de Masqueray, que les problèmes qui nous intéressent au premier chef dans le cadre de la deuxième partie de ce travail, à savoir l'aspect linguistique pur, plus précisément grammatical ou lexical de l'œuvre de notre auteur, n'étaient pas ceux que lui passait au premier plan : effet de la forte personnalité de Masqueray, capable de s'intéresser à la fois à l'archéologie romaine, à l'histoire politique et religieuse, à la langue berbère (et ses variétés), capable de fouiller Timgad ou Madaure, de traduire la chronique d'Abù Zakariyyâ ou le Kitâb al-Nil, de faire un dictionnaire touareg ou un dictionnaire chaoui (qu'il n'a pas publié). Nous n'envisagerons ici qu'à peine le tiers environ de son activité scientifique. C'est donc un tableau incomplet. Mais ce tableau limité ne donnera pas pour cela une vue déformante, et, avec le secours de toute une correspondance quasi inédite que nous avons pu réunir, nous nourrissons le souci de retrouver l'homme derrière l'œuvre, l'homme qui, avec plus ou moins de métier et plus ou moins de bonheur, a pu aborder l'une ou l'autre de ses disciplines favorites avec le même tempérament, les mêmes qualités et les mêmes défauts.
Chapitre I : Années de jeunesse Chapitre II : A l'École supérieure des Lettres d'Alger (1880-1886) Chapitre III : A l'École supérieure des Lettres d'Alger (1886-1894)
Chapitre I : Généralités, le kabyle, le mozabite et varia Chapitre II : Le berbère-chaoui Chapitre III : Le touareg-taitoq Chapitre IV : Masqueray, les études berbères et la France
|
|
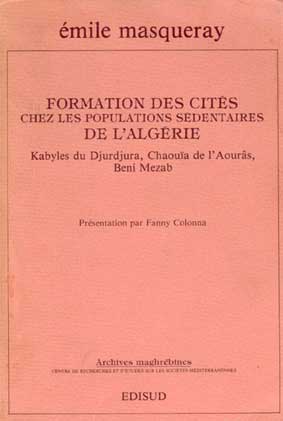 |
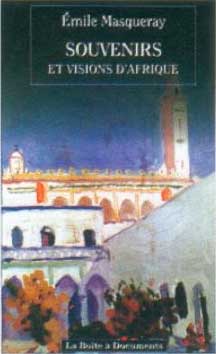 |